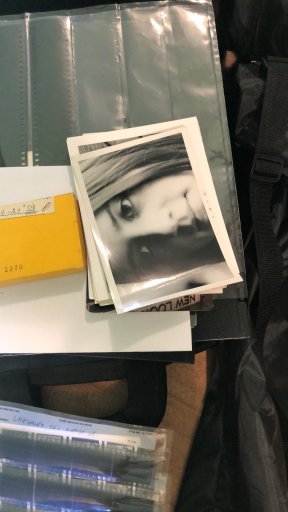Le CN D accueille et accompagne une résidence d’écriture du Département de la Seine-Saint-Denis : « Écrivain·e·s en Seine-Saint-Denis ». Celle-ci permet à l’écrivaine Hélène Giannecchini de s’immerger dans les ressources du CN D et en dialogue avec les nombreux publics et acteurs et actrices du lieu. Son projet d’écriture sera le support d’une conférence performée sur la notion de corps queer. La danse a été l’un des lieux d’expression privilégiée de ces corps parfois considérés comme hors-norme. Les dix mois de résidence seront consacrés à l’écriture de ce texte et à la rencontre et l’échange avec les publics du CN D. Plusieurs actions de médiations sont envisagées : conférences, débats, rencontres, atelier d’écriture, etc.
À l’occasion de cette résidence, Hélène Giannecchini tiendra une permanence littéraire une fois par mois
Comment réussir à travailler, organiser son temps, trouver une résidence, rédiger un dossier de candidature, faire un workshop, préparer un manuscrit, organiser ses relectures, trouver des stratégies économiques pour écrire, avoir un bureau, etc. L’écriture n’est pas qu’une question d’inspiration : elle est aussi faite de réalités matérielles. Dans le cadre de sa résidence au Centre national de la danse, l’écrivaine Hélène Giannecchini propose une permanence mensuelle pour répondre à toutes les questions que l’on n’ose pas poser.